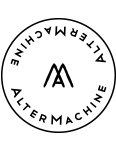Monter Bernhard aujourd’hui, en France, en Suisse, pour ramasser quelque chose qui est dit et redit dans son oeuvre, c’est une manière de penser, de dire, de voir, de crier en silence, de vociférer du dedans, de ruminer en parlant, sûrement pas un geste formel et musicalement immaculé. Il s’agit de trouver l’origine de cette véhémence noire et pourtant terriblement vivante avec l’humour qu’elle contient, et pour celui en train de la formuler et pour le spectateur. Ce mouvement aigu et brillant de formules lapidaires, même s’il semble finalement stérile, même s’il est souvent un aveu de faiblesse sous le règne compulsif de la mauvaise foi, est en tout cas l’invention d’une langue pour dire et l’excellence et la déchéance, et la soumission et la tyrannie, et la fureur de vivre et l’impuissance dans un monde dont «le ventre est toujours fécond».
Comme chez Marivaux tous les titres des pièces de Bernhard semblent interchangeables. Il faudra que s’invente un théâtre burlesque et extravagant. Si le théâtre est bien le lieu privilégié pour convoquer les absents dans des mascarades tout aussi violentes les unes que les autres, ce sera aussi un théâtre hégémonique par les multiples rôles que la famille nous assigne à jamais, les mises en scène de soi qu’imposent cette colère active, les référents permanents aux arts de la scène (le concert, le théâtre), un théâtre dans le théâtre, un théâtre sur le théâtre, un théâtre sous le théâtre, un théâtre avant et après le théâtre (la retraite), un théâtre contre le théâtre.